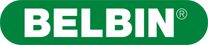Grâce à l’imagerie cérébrale, les scientifiques découvrent les régions du cerveau qui s’activent davantage quand on est heureux ou quand on rumine. Ils savent même comment « stimuler » le bonheur : on doit se concentrer sur le moment présent.
Évoquer la neurobiologie à propos du bonheur peut paraître étrange tant cet état d’âme appartient à des moments intimes, loin de tout matérialisme. Le bonheur est un état de bien-être et de satisfaction : on est assailli de sentiments positifs, et l’on est capable de prendre conscience de ces émotions et de les savourer. Une « dissection » neurobiologique du bonheur consiste à étudier les réactions cérébrales et biologiques associées non seulement aux émotions positives, mais aussi aux états de conscience qui leur sont liés, que l’on soit seul ou en groupe quand on éprouve ces sentiments agréables. Nous allons aborder les travaux récents de ce domaine : ils montrent que les états de bien-être les plus subjectifs sont ancrés dans le cerveau.
Comment étudier le bonheur et les émotions positives dans le cerveau ? Les méthodes actuelles d’imagerie cérébrale fonctionnelle, telle l’imagerie par résonance magnétique (IRM), permettent de visualiser l’activité des neurones à un moment donné et dans des conditions particulières. Pour ce faire, on immobilise le participant dans un appareil d’IRM clos : il est loin d’être dans un état de bonheur « naturel et réel », mais c’est aujourd’hui la meilleure façon possible d’étudier l’activité cérébrale.
« Voir » les émotions positives
On peut provoquer des émotions précises en présentant des photos de visages, dont on fait varier l’expression émotionnelle. Bien sûr, on ne parle pas d’émotions « fortes » dans ce type de conditions expérimentales ; mais le fait de regarder un visage gai, triste ou en colère déclenche chez tous les individus des réactions quantifiables et reproductibles de l’activité cérébrale. D’autres d’images engendrent des émotions variées, par exemple la peur avec des scènes dangereuses ou le dégoût avec des objets repoussants.
Ainsi, on peut identifier les régions cérébrales, ou les réseaux, qui fonctionnent de façon plus intense quand on ressent de l’anxiété ou de la joie. L’amygdale, l’insula et l’hippocampe sont suractivés quand on a peur, alors que ce sont le cortex préfrontal dorsolatéral, les aires cingulaires, les aires temporales inférieures et certaines régions du cervelet quand on est heureux (voir l’encadré page 29).
Le plaisir de jouer à se faire peur
Avec ces méthodes, on dessine la cartographie d’un cerveau « heureux », où « s’allument » les régions de la joie et « s’éteignent » les régions associées à des émotions négatives telles la tristesse, la peur, la colère, etc. En plus de ces zones activées lors des émotions positives, on connaît d’autres réseaux associés à l’obtention d’une récompense, c’està- dire d’une sensation agréable. Il s’agit du cortex préfrontal ventromédian et du noyau accumbens (dans le striatum), structures surtout contrôlées par la dopamine, une molécule de communication entre neurones sécrétée notamment par l’aire tegmentale ventrale. Ce neurotransmetteur sous-tend l’effet positif ressenti par exemple lors de la prise de drogues, et participe à la plupart des mécanismes de la dépendance.
Cependant, il n’existe pas deux systèmes distincts, deux cerveaux émotionnels, traitant séparément les émotions positives et négatives. Certaines régions associées aux émotions sont communes, dans le système limbique (l’ensemble des régions cérébrales traitant les émotions) ou à sa périphérie notamment. D’ailleurs, on ressent parfois le même genre d’excitation agréable quand on a peur (dans un contexte sécurisé) et quand on est heureux : c’est probablement la raison pour laquelle on aime jouer à se faire peur. Plusieurs molécules cérébrales provoquent dans ces réseaux des sensations de bienêtre ; ce sont par exemple les opiacés endogènes (de la famille de la morphine). Mais les principaux neurotransmetteurs de ces structures – la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline – modulent aussi bien les émotions positives que négatives, selon de subtils équilibres.
D’autres études scientifiques indiquent que, dans des régions cérébrales précises, joie et tristesse se côtoient. C’est le cas dans le noyau sous-thalamique, petite structure nichée au cœur du cerveau dans les ganglions de la base. Ce noyau est la cible des traitements par stimulation électrique profonde visant à soulager la maladie de Parkinson et les troubles obsessionnels compulsifs. On implante des électrodes dans ce noyau lors d’une intervention neurochirurgicale et on les relie à un stimulateur électrique placé sous la peau. Des neurologues à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière avaient déjà montré que des états dépressifs transitoires (de grande tristesse et de désespoir) sont déclenchés chez des patients atteints de la maladie de Parkinson selon l’intensité de la stimulation appliquée. En 2007, nous avons observé, avec le psychiatre Luc Mallet de la Pitié- Salpêtrière, que des intensités de stimulation différentes provoquent chez les patients une forme de gaîté excessive, proche des syndromes maniaques. Certaines régions cérébrales, dont le noyau sous-thalamique, auraient donc la capacité, selon leur activité, de produire ou de moduler des émotions variées, de la joie à la tristesse.
L’économie cérébrale du bonheur
Mais cette approche presque « simpliste » des états émotionnels ne donne accès qu’à une vision statique de la vie affective, alors qu’en fait, on éprouve rarement les mêmes émotions, et, souvent, on les anticipe. En effet, les émotions sont les ingrédients essentiels de la motivation à agir. Anticiper un plaisir sensoriel, physique ou social conduit à mobiliser de l’énergie pour atteindre cet objectif, quitte à prendre des risques ou à consentir des efforts importants : travailler beaucoup pour préparer ses vacances ou sa retraite, sortir dans le froid pour partager un dîner au restaurant avec des amis, ou encore s’inscrire à un club de sport en espérant y faire des rencontres…
Ces plaisirs anticipés, dont on espère qu’ils procureront des moments de bonheur, font l’objet de calculs prévisionnels dans le cerveau. C’est ce que les chercheurs en « neuroéconomie » étudient : ils ont montré que des systèmes neuronaux participent à une « comptabilité inconsciente » qui met à tout moment en balance le coût d’une action à mener, en termes d’effort mental ou physique, et le bénéfice à en tirer au plan hédonique (pour le plaisir). Cette analyse du « pour » et du « contre » est une composante essentielle des mécanismes cognitifs de la prise de décision : l’action est déclenchée quand le rapport gain/coût est favorable. Mais les bénéfices attendus sont variables et parfois abstraits ou symboliques : plaisir gustatif, acte sexuel, enrichissement matériel, épanouissement intellectuel, etc. Pourtant, le cerveau a la capacité de convertir ces gains subjectifs en une « monnaie » unique, neuronale, permettant de classer les différents choix possibles. Ainsi, des psychologues britanniques ont montré que cette « monétisation » du plaisir espéré entraîne l’activation, plus ou moins intense, du cortex préfrontal ventral. Il existe donc une économie cérébrale du bonheur, encore plus précieuse en ces temps de crise…
L’ocytocine ou le bonheur partagé
Une autre réalité du bonheur est qu’il est souvent partagé. Les émotions positives favorisent le rapprochement des individus, ce qui augmente les chances de survie et de reproduction, la défense et les progrès de l’espèce. Nous avons vu que le système de la récompense peut être activé pour le plaisir social et les autres types d’émotions positives, via la dopamine dans certaines régions cérébrales (le cortex ventromédian et le noyau accumbens).
Mais désormais, on considère qu’une autre molécule est synonyme de bonheur partagé : l’ocytocine. Ce petit peptide est sécrété par une glande située à la base du cerveau, l’hypophyse, et est connu principalement pour favoriser l’accouchement et la lactation. En fait, il a d’autres effets dans le cerveau, qui facilitent le rapprochement entre individus.
De l’attachement du nouveau-né à sa mère aux relations de confiance entre adultes, en passant par l’orgasme, l’ocytocine semble impliquée dans toutes les situations d’interactions sociales positives. Par exemple, quand on administre (par inhalation) cette substance à deux individus, on augmente leur coopération. L’ocytocine diminue aussi les disputes conjugales ! Certains scientifiques en font même l’hormone de la morale, après que d’autres en ont fait – un peu vite – l’hormone de l’amour.
La participation de l’ocytocine à l’attachement affectif n’est pas spécifique de l’être humain. Par exemple, il existe deux types de campagnols, qui se distinguent selon leur mode de « vie conjugale » : le campagnol des prairies vit en couple avec le même partenaire durant toute sa vie, et le campagnol des montagnes est plus volage et change facilement de partenaires. Ces deux types, très proches génétiquement, ont des concentrations sanguines d’ocytocine distinctes : élevées chez les fidèles, quasi nulles chez les volages. Et on a montré que l’administration d’ocytocine aux campagnols des montagnes les faisait adopter le comportement rangé et fidèle de leurs cousins des prairies.
En plus de ce facteur neurochimique, le bonheur à deux repose sur des fonctions cérébrales que l’on commence à identifier. Elles mettent en jeu un réseau de structures impliquées dans les échanges avec autrui – le cerveau social – qui comprend notamment le sillon temporal supérieur, l’amygdale, l’insula antérieure et le cortex cingulaire antérieur (voir la figure 2). Ce réseau participe à la compréhension d’autrui, à l’anticipation de ses réactions, à l’empathie et à tous les phénomènes de résonances émotionnelles.
Il est compliqué d’étudier de façon précise et approfondie les réactions simultanées de deux « cerveaux » communiquant entre eux, mais on commence à utiliser certains dispositifs expérimentaux pour y parvenir. Par exemple, on filme deux personnes placées dans un appareil d’IRM et chacune peut voir l’autre, ou on les place face à face en enregistrant l’activité électrique de leur cerveau par électroencéphalographie (EEG). Les premières études de ce type, qui ne concernent pas encore le bonheur partagé, montrent que les régions du cerveau social tendent à « vibrer » de façon synchronisée lorsque les deux personnes communiquent, en s’imitant notamment.
L’activité cérébrale lors de l’orgasme
La situation emblématique du bonheur ou du plaisir à deux est naturellement celle du rapport sexuel. L’étude des changements neurobiologiques associés au plaisir sexuel ou à l’orgasme est aussi compliquée (là encore pour des raisons méthodologiques !), mais on sait que plusieurs substances cérébrales jouent un rôle dans l’état de bien-être qui y est associé : les endorphines, l’ocytocine et la prolactine. Ces molécules sont sécrétées par l’hypophyse, qui est elle-même contrôlée par l’hypothalamus. L’effet de ces substances s’ajoute à ceux de la dopamine et du système de la récompense. Récemment, Barry Komisaruk, de l’Université du New Jersey, a montré, grâce à un enregistrement unique de l’orgasme d’une femme dans un appareil d’IRM, que le plaisir sexuel s’accompagne d’une suractivation transitoire de la plupart des régions cérébrales, et notamment des structures émotionnelles et de celles sécrétant la dopamine (par exemple l’aire tegmentale ventrale).
Mais être heureux, c’est surtout prendre conscience de son bien-être ; cette capacité d’auto-observation est probablement ce qui différencie le plus la vie émotionnelle de l’être humain de celle des autres espèces. Cette « conscience réflexive » est possible
grâce au développement considérable, dans le cerveau humain, du cortex préfrontal, où convergent la plupart des informations cérébrales ; le cortex préfrontal élabore des pensées et permet d’avoir une vie intérieure. Réfléchir sur soi-même présente beaucoup d’avantages, par exemple pour résoudre les problèmes et anticiper les événements, mais comporte aussi quelques inconvénients.
Le cerveau a la capacité de traiter de nombreuses informations en parallèle, telles que l’action en cours – je lis ce texte – en plus d’un souvenir dérangeant – je me suis fâché avec mon meilleur ami il y a deux semaines – et d’un souci à régler en « tâche de fond » – je dois prendre rendez-vous avec le directeur de l’école de mon fils. Qui plus est, le cerveau est vulnérable au plan émotionnel. Récemment, de nombreuses études ont montré que la tendance à laisser son esprit divaguer de façon automatique le conduit souvent à des « cogitations » stériles et délétères. En effet, ce sont des questionnements détachés de l’instant présent, sans solutions concrètes possibles, qui se transforment vite en pensées négatives et en ruminations.
Les ruminations : un frein au bonheur
Les personnes souffrant d’anxiété ou de dépression sont particulièrement sensibles à ces passages en « mode ruminatif » qui peuvent faciliter les rechutes. Mais on a aussi montré que, chez tout un chacun et hors contexte psychopathologique, l’incapacité à rester concentré sur le moment présent diminue le bien-être. Des éléments négatifs du passé ou de l’avenir anticipé envahissent l’esprit, qui ne peut alors plus tirer satisfaction des situations réellement vécues.
On étudie les fondements cérébraux de ces freins au bonheur depuis quelques années. Ainsi, lorsque l’esprit « vagabonde », des structures neuronales formant le « réseau du mode par défaut » s’activent plus que les autres. En IRM fonctionnelle, ces régions sont davantage activées quand le participant n’a pas de consigne précise et qu’il ne pense à rien de particulier. Ce réseau comprend des structures situées dans l’ensemble du cerveau, mais fortement connectées, et qui sont surtout rassemblées autour de la ligne médiane, à la frontière des deux hémisphères : cortex préfrontal médian, cortex cingulaire postérieur, precuneus (voir la figure 4). Ces régions sous-tendent d’autres fonctions qui consistent à porter une attention particulière sur soi-même, par exemple penser à ses traits de personnalité ou à des souvenirs. Ce mode par défaut du cerveau serait en quelque sorte une introspection quasi automatique, qui isole du monde extérieur et tend à renforcer les états d’âmes négatifs.
Se concentrer sur l’instant présent
Alors peut-on lutter contre ces ruminations qui font obstacle au bonheur ? C’est probablement une des conséquences des pratiques de méditation, dont il existe de nombreuses formes, philosophiques ou non, mais dont le point commun est d’apprendre à rester concentré sur le moment présent. Cet objectif d’entraînement attentionnel est au coeur des méthodes actuelles de « thérapie cognitive de pleine conscience » (mindfulness), qui sont de plus en plus proposées.
Ces thérapies permettent à l’individu, avec des exercices réguliers, d’être de plus en plus attentif aux expériences sensorielles et émotionnelles qu’il vit à un moment donné. Elles visent aussi à réduire notre propension à porter des jugements, à interpréter les événements ou à se laisser entraîner dans des pensées qui éloignent de l’instant présent.
Elles proposent par ailleurs de cultiver des émotions prosociales, telles la compassion et la gentillesse. Ces méthodes thérapeutiques ont un effet positif sur l’humeur, avec des résultats convaincants quant à la prévention des rechutes chez les patients ayant souffert de plusieurs épisodes de dépression.
Les conséquences cérébrales de la méditation
On commence à décrypter les conséquences cérébrales des pratiques de méditation. C’est le cas notamment de l’équipe de Richard Davidson, à l’Université du Wisconsin-Madison,  qui travaille depuis de nombreuses années avec le moine bouddhiste Matthieu Ricard. Ils ont montré que les personnes devenues expertes de la méditation, après plusieurs milliers d’heures de pratique, ont une réaction cérébrale très spécifique en EEG : leurs ondes gamma sont beaucoup plus intenses que celles des sujets non entraînés. Ces ondes gamma s’accompagnent d’une meilleure synchronisation de l’ensemble de l’activité électrique du cerveau et l’augmentation de leur intensité montre que ces personnes sont extrêmement vigilantes lors des exercices de méditation soutenue. Elles témoignent aussi probablement d’une augmentation de la neuroplasticité, c’est-à-dire de la propension des neurones à établir davantage de connexions.
qui travaille depuis de nombreuses années avec le moine bouddhiste Matthieu Ricard. Ils ont montré que les personnes devenues expertes de la méditation, après plusieurs milliers d’heures de pratique, ont une réaction cérébrale très spécifique en EEG : leurs ondes gamma sont beaucoup plus intenses que celles des sujets non entraînés. Ces ondes gamma s’accompagnent d’une meilleure synchronisation de l’ensemble de l’activité électrique du cerveau et l’augmentation de leur intensité montre que ces personnes sont extrêmement vigilantes lors des exercices de méditation soutenue. Elles témoignent aussi probablement d’une augmentation de la neuroplasticité, c’est-à-dire de la propension des neurones à établir davantage de connexions.
En IRM fonctionnelle, les experts en méditation présentent non seulement une activité faible du réseau du mode par défaut qui sous-tend les ruminations (voir la figure 5), mais aussi une activité importante dans les régions du cerveau social participant à l’empathie : l’insula et la jonction temporo-pariétale. L’épaisseur de certaines régions corticales (cortex préfrontal, gyrus temporal supérieur, insula) peut même être augmentée sous l’effet de la méditation, là aussi parce que les neurones sont davantage connectés. Et le volume de l’insula augmente avec le nombre d’heures passées en méditation.
D’autres études ont montré que la pratique de la méditation, même sur une courte période (huit semaines), engendre une diminution du volume de certaines parties de l’amygdale, impliquées dans la production de l’anxiété et activées par les événements stressants. Enfin, les exercices de méditation modifieraient le métabolisme cérébral, en diminuant l’activation des structures du réseau du mode par défaut associées aux risques de rumination. Ainsi, ces effets neuronaux des pratiques de pleine conscience expliquent les résultats favorables obtenus sur l’humeur et le bien-être.
Le bonheur en héritage
Même si les recherches sur les facteurs génétiques de la propension au bonheur restent préliminaires et à interpréter avec prudence, des chercheurs américains ont montré en 2013 que la tendance au bienêtre est liée à certains profils génétiques, et notamment à un gène codant l’enzyme MAO-A. Cette enzyme est responsable du métabolisme et de l’activité de certains neurotransmetteurs, telle la dopamine. Ceci confirme que les états d’âmes sont ancrés dans la biologie et le patrimoine génétique. C’est d’ailleurs le cas de toutes les émotions, qui ont permis à l’homme de survivre et de s’adapter à des conditions souvent hostiles et changeantes. On résout aujourd’hui des problèmes abstraits et on réfléchit sur soi-même, mais on reste en grande partie gouverné par ses émotions, qu’il est souvent préférable de laisser s’exprimer. Connaître les fondements cérébraux et physiologiques de la propension au bonheur est utile, que ce soit par curiosité intellectuelle ou pour progresser dans la connaissance de soi.
Bibliographie
- H. Chen et al., The MAO-A gene predicts happiness in women, in Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, vol. 40, pp. 122-125, 2013. J.
- Brewer et al., Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity, in PNAS, vol. 108, pp. 20 254- 20 259, 2011.
- F. Grabenhorst et al., A common neural scale for the subjective pleasantness of different primary rewards, in Neuroimage, vol. 51, pp. 1265- 1274, 2010.
- L. Mallet et al., Stimulation of subterritories of the subthalamic nucleus reveals its role in the integration of the emotional and motor aspects of behavior, in PNAS, vol. 104, pp. 10 661- 10 666, 2007.
Références
- Article paru dans la revue Cerveau & Psycho, L’essentiel N°14 mai-juillet 2013. www.cerveauetpsycho.fr
- Auteur de l’article : Antoine Pelissolo est professeur de psychiatrie à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et à l’Université Pierre et Marie Curie, à Paris. Thomas Mauras est psychiatre à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), à Paris.